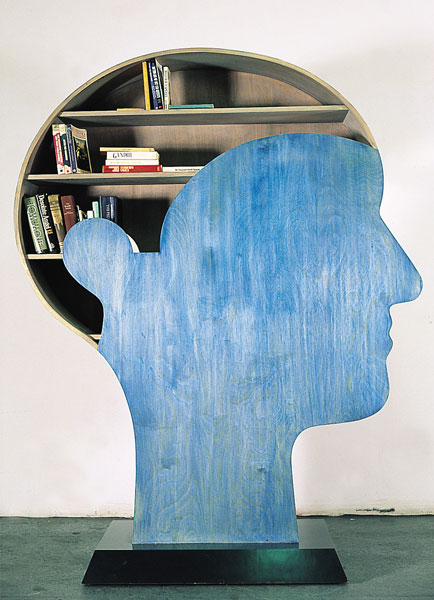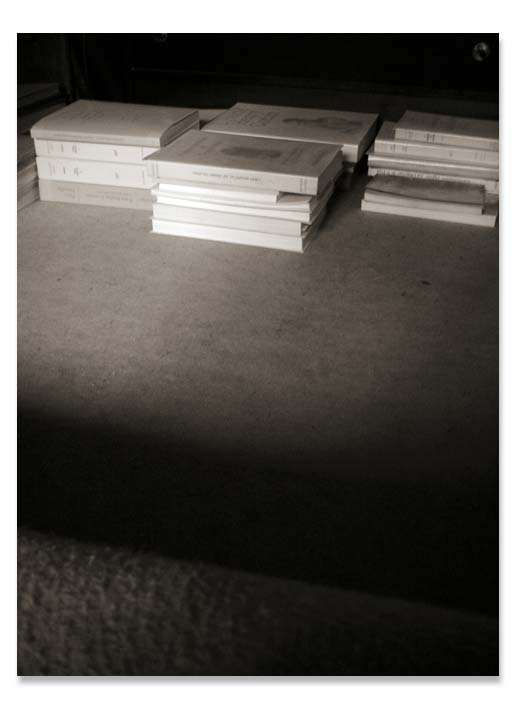L’ART D’ECRIRE A L’USAGE DES AUTEURS
Les auteurs sont de bons lecteurs pour les donneurs de conseils sur la manière d’écrire et de se faire éditer.
Sur les chiffres de base, tout le monde est à peu près d’accord. Chaque année, quelque 50 000 manuscrits sont proposés au 760 éditeurs français qui, s’ils viennent d’inconnnus, les publient à raison d’environ 5 pour 1 000. Déduction : il existe un marché potentiel d’environ 49 750 personnes pour les ouvrages expliquant la manière de s’y prendre. Aux auteurs désireux d’exploiter ce marché, encore anarchique, on proposera ici quelques recettes sur l’art d’écrire un livre sur le dit art.
1. Alimenter la paranoia (mais pas de trop quand même)
Le lecteur visé s’étant déjà vu refuser un ou plusieurs manuscrits, on peut considérer qu’il nourrit à l’égard du monde éditorial un solideressentiment. on n’hésiteras pas à conforter sa conviction :
a) que les éditeurs ne lisent pas les livres arrivés par la poste ;
b) que, s’ils viennent par désoeuvrement à en feuilleter un et à y repérer une promesse de talent, ils n’ont rien de plus pressé que de l’enterrer, par jalousie d’auteurs ratés ;
c) qu’ils ne publient jamais que des auteurs déjà publiés, sorte de mafia soudée par la terreur de voir des nouveaux venus leur disputer des miettes du gateau.On passera sans insister sur le fait :
a) que les auteurs publiés ont tout d’abord été des auteurs inédits, et la plupart du temps de parfaits inconnus ;
b) que l’intérêt d’un éditeur, et souvent sa passion, est précisement de découvrir de nouveaux talents ;
c) que l’intérêt du lecteur à gages n’est pas seulement d’expédier au plus vite cette besogne sous-payée, mais aussi de sortir de temps à autre un livre publiable, et que sa terreur serait plutôt de refuser Proust, comme l’a fait Gide, ou Céline comme presque tout le monde.
Plutôt que de rappeler ces évidences, lourdes d’une vérité désagréable (la grande majorité des manuscrits est illisible), on multipliera les anecdotes terrifiantes : placards bourrés de manuscrits jamais ouverts, en instance de renvoi, ou expériences comme celle d’Anne Gaillard qui avait adréssés à dix éditeurs parisiens les manuscrits de Hans d’Islande, de Victor Hugo, et de Mon village à l’heure allemande, prix Goncorut, de Jean-Louis Bory, et avait reçu neuf circulaires de refus (seul Georges Piroué, chez Denoel, avait éventé la supercherie).
A ce stade cependant, l’exercice présente une difficulté, qui lui donne sa saveur artistique : il s’agit, tout en noircissant au maximum le tableau, de laisser une lueur d’espoir. De présenter l’édition comme une forteresse presque inxepugnable, le presque justifiant l’emplette du livre salvateur. Et là, on est au pied du mur, il faut donner des recettes.
2. Délayer les recettes
Le malheur, c’est que les recettes pour être lues tiennent en quelques lignes, disons quelques feuillets. Il est certes bon d’expliquer à un auteur sans expérience :
a) qu’un manuscrit ne doit en aucun cas être manuscrit, mais dactylographié, si possible proprement ;
b) que les fautes d’orthographe font mauvais effet et qu’il convient de se relire avec soin ;
c) qu’il vaut mieux ne pas adresser un recueil de poèmes à un éditeur de manuels techniques.
Seulement, ces pertinentes remarques ne font pas un livre, il faut trouver des astuces pour remplir : des listes commentées de machines à écrire, des conseils de présentation, des bibliographies (dictionnaire des synonymes, des difficultés de la langue française, etc.), des adresses d’éditeurs, recopiées dans Livre-Hebdo.
Certains auteurs, plus ambitieux, prennent le problème à la racine et traitent, non seulement de l’art de publier, mais celui de l’écrire : il faut choisir son genre (roman, poème, traité de théologie, décidez-vous, bon dieu !). Faire un plan. Donner de la chair aux personnages. Tâcher que les phrases sonnent bien... Il va de soi que ces recettes ne peuvent que décevoir quiconque rechercherait une formule magique, mais on n’en voit guère d’autre et il faut reconnaître que, même quand une romancière aussi douée que Patricia Highsmith prétend vous initier à l’art du suspense, elle débite exactement les mêmes platitudes. Cela dit, entre le « fond » et « la forme », un auteur entraîné devrait, en tirant à la ligne, s’arracher sans trop de peine cent pages sur le sujet, ensuite on les imprimera gros. (Contre-exemple : le seul ouvrage recommandable du genre est un pavé de 400 pages, « le Guide pratique de l’écrivain », de Jean Guénot, qui, du premier titillement de l’inspiration aux embûches des contrats, examine avec compétence, sérieux, humour et modestie tous les aspects artisanaux du travail littéraire.)
3. Proposer une solution miracle
Une fois :
a) démontré qu’il est presque impossible de se faire éditer ;
b) étiré aux dimensions d’un livre une dizaine de conseils de bon sens, l’auteur en général s’arrête, ce qui plaide pour son honnêteté. Il serait imprudent de sa part de proposer le remboursement de sa méthode aux usagers qui, l’ayant indiquée, continueraient à essuyer des refus. Il ne lui reste en conclusion qu’à prodiguer de bonnes paroles, où un espoir ténu le dispute à la consolation anticipée : « Si ça ne marches pas; recommencez... Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage... », Il s’éclipse, navré de n’avoir pas de solution miracle à proposer. C’est alors qu’intervient et se démarque des concurrents l’auteur qui, justement, en a une.
Cet auteur existe, il s’appelle Jérôme Hesse et, à la page 175 de son « Comment écrire un livre et être édité » (Alain Moreau), jusque-là une laborieuse compilation de truismes, il paye de sa personne : « Tenez nous allons passer une sorte d’accord. si vous êtes refusés par cinq éditeurs différents, après que vous aurez suivi les conseils rassemblés dans ce guide...eh bien c’est à moi que vous l’enverrez avec les lettres de refus que vous aurez reçues. Si vous avez vraiment tout tenté sans succès, je m’engage à y réfléchir avec vous. Ecrivez-moi... »
La sanyète qui suit est imaginaire, mais plus vraisemblable : vous vous rendez, avec votre manuscrit et vos lettres de refus sous le bras, au rendez-vous que vous fixe l’obligeant Jérôme Hesse, chez l’éditeur Alain Moreau. Et là, le ciel s’entr’ouve, car le clairvoyant Jérôme Hesse feuillette votre chef-d’oeuvre et vous dit qu’à vue de nez, c’est fort intéressant, il va le faire passer en comité de lecture confirme cette excellente opinion. On vous fixe un second rendez-vous, dans ce même du hôtel du Marais, mais cette fois, vous entrez par la grande porte, rue Charlemagne, et c’est le grand patron, Alain Moreau soi-même, que vous aller rencontrer. Il ne tarit pas d’éloges sur votre prose, de railleries à l’égard de concurrents qui en on négligé l’abaine, il vous parle déjà du lancement publicitaire et pour finir vous tend un contrat mirobolant aux termes duquel vous participez, à hauteur de 50 000 francs à l’impression de l’ouvrage.
Quelques mois plus tard, délesté de vos économies et nanti d’un confortable matelas de bouquins invendus, invendables et que personne ne songe à vendre, vous rejoingez le CALCRE (Comité des auteurs en lutte contre le racket de l’édition). Là, d’autres échaudés vous expliquent que le même immeuble, comme à la maison du docteur Jekyll et de Mr Hyde, abrite les respectables éditions Alain Moreau (qui ont publié, par exemple; « Suicide mode d’emploi », ou un livre de... Jérôme Hesse, rabatteur en chef) et la prospère PU, conçue et dirigé par le même Alain Moreau qui, lorsque ses « auteurs », s’estimant escroqués, ont le front de se plaindre, leur renvoie des lettres ainsi libéllées : « De votre banlieue, d’où vous lancez vainement des signes de reconnaissance vers le monde des lettres qui, de temps à autres, vous distille quelque marge de pitié. Je vous imagine grisâtre, déjà un peu enveloppé, refusant d’admettre, au contraire de votre entourage, qui lui a tout compris, que votre jeunesse est loin et que vous ne l’écrivez jamais, ce grand livre dont l’annonce perpétuelle vous servait d’alibi pour ne rien faire ».
4. Trouver un éditeur
Donc, en vous inspirant des conseils ci-dessus, vous avez écrit un petit livre, encore inédit, sur l’art d’être publié. Si, pour l’une ou l’autre raison, vous dédaignez les services tarifiés de Jérôme Hesse et Alain Moreau, ces bienfaiteurs de l’humanité, il vous reste à trouver un éditeur. Bizarrement, alors que le sujet devrait, comme on l’a vu, intéresser un large public, Gallimard, Grasset et le Seuil, auxquels vous aviez songé tout d’abord, vous assurant poliment qu’en dépit de ses réelles qualités littéraires, votre ouvrage n’entre pas dans le cadre de leurs collections. En examimant plus attentivement les couvertures des livres publiés sur le sujet vous constatez que le « Guide pratique de l’écrivain », de Jean Guénot, est publié chez Jean Guénot, et le guide homonyme de J-J. Nuel chez J-J. Nuel. Quant au « Manuel de l’écrivain néophyte » de Fabien Perruca, il paraît chez Michel Dansel, assorti de l’inquiétant copyright « SOS manuscrits », qui sent son officine de rewriting à plein nez. Vous êtes troublé, moi aussi. Finalement, vous décidez comme tout le monde d’écrire un gros roman sur vos premières amours. Quand vous l’aurez fini, tapé et enveloppé, n’oubliez surtout pas de l’affranchir (je ne sais pas ce qui me prend de donner gratuitement des conseils pareils...).
(1) Dans le cas de Guénot, auteur de plusieurs livres dans le circuit normal, l’auto-édition résulte d’un choix personnel, qu’il justifie sans prosélytisme, précisant que ce contrôle absolu de son traail se paie de mille tracas.
5. Guide des guides
Entre le meilleur, qui dépasse largement ce sujet (Jean Guénot : Guide pratique de l’écrivain chez Jean Guénot, 85, rue des Tenerolles , Saint-Cloud), et le pire (Jérôme Hesse, déjà cité), signalons un livre honnête, quelque peu délayé mais plein de conseils raisonnables : Guide pratique à l’usage des auteurs qui veulent publier leurs livres, par MM. Friedman et P. Rouchaléou, éditions Rochévingnes. Par ailleurs, outre ses cahiers de doléances dirigés contre la Pensée Universelle, le CALCRE (BP 1794400 Vitry Cedex) a récemment publié AUDACE, un Annuaire à l’Usage des Auteurs Cherchant un Editeur, sorte de banc d’essai des maisons d’édition françaises, contenant un tas de resnseignement utiles pour ne pas se fourvoyer dès le départ.